Plaine des Jarres : mystères archéologiques et mémoire de guerre
Explorez la Plaine des Jarres, site UNESCO au Laos : entre légendes, vestiges archéologiques et cicatrices de la guerre du Vietnam. Un lieu hors du temps.
BLOG LAOS
10/23/20251 min temps de lecture
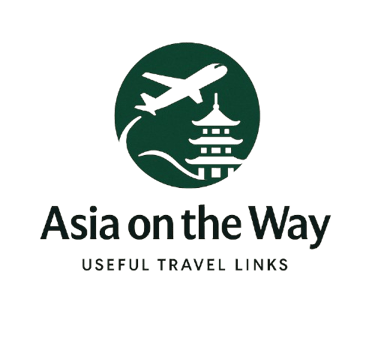
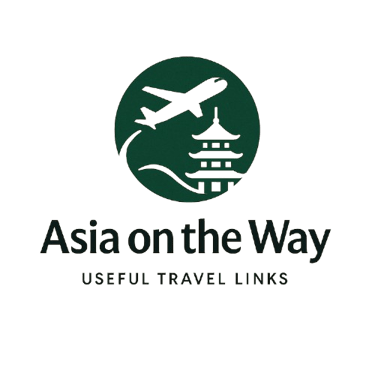
Voyage
Conseils pratiques pour voyager en Asie facilement et tout savoir sur les visas, banques, budget, voyage et plus.
© 2026. All rights reserved.