Les brûlis au Laos : tradition et défi écologique
Découvrez les brûlis au Laos, entre pratique agricole ancestrale, odeur persistante de fumée, impacts écologiques et regard des voyageurs.
BLOG LAOS
9/25/202517 min temps de lecture
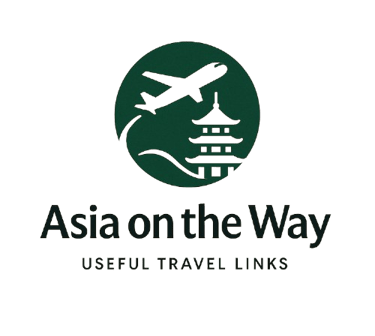
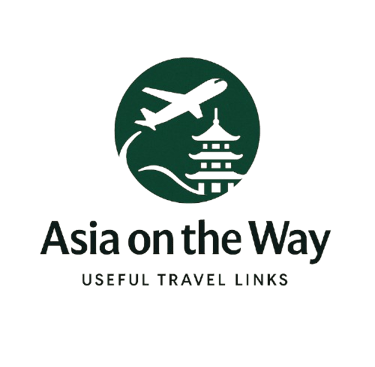


Voyage
Conseils pratiques pour voyager en Asie facilement et tout savoir sur les visas, banques, budget, voyage et plus.
© 2026. All rights reserved.